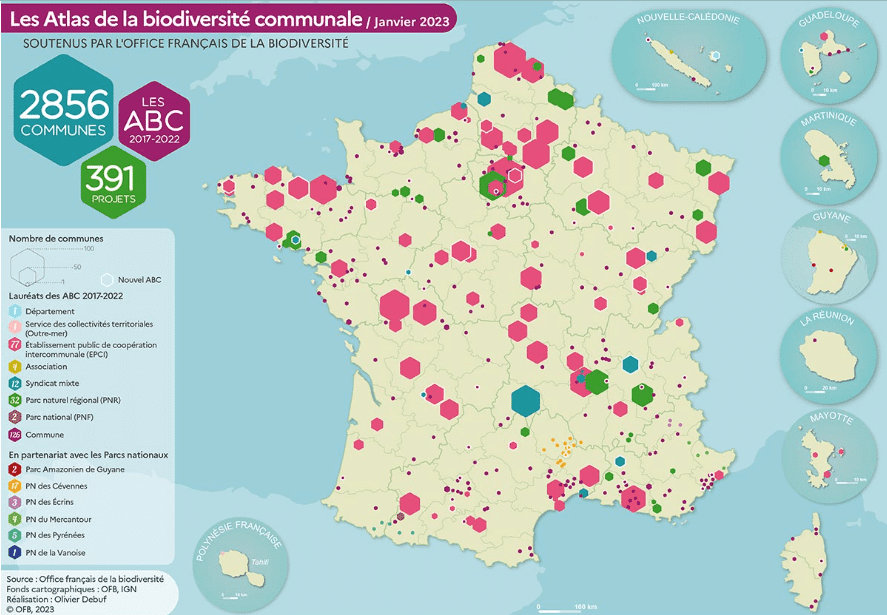6 Avril 2023
Un train peut en cacher un autre : au moment où la loi sur les retraites requiert l’attention du mouvement social, et qu’un énième projet sur l’immigration mobilise les organisations de défense des droits des migrant-es, le gouvernement prévoit de faire voter une nouvelle loi de programmation militaire. Du fait de cette « stratégie du choc », ce projet risque de passer inaperçu.
Le déficit de contrôle démocratique est accru, puisque l’actuelle loi se poursuit jusqu’en 2025. Sans bilan de ce qui est en cours, dans un contexte géostratégique de plus en plus tendu, l’objectif déclaré est de s’adapter aux risques de conflit inter-étatique majeur (de « haute intensité »). Ajoutée aux retraits des corps expéditionnaires du Mali et du Burkina-Faso, retraits imposés par les peuples et leurs gouvernements, et à la dénonciation des accords de coopération militaire datant de 1961, cette situation devrait amener un vrai débat dans le pays.
Le président Macron, chef des armées, demande une augmentation qui aboutit, en faisant la somme des deux lois (2018-2025 & 2024-2030), au doublement de leur budget et à l’instauration d’une « économie de guerre ». La hausse budgétaire en Allemagne est inférieure (approximativement de 100 milliards d’euros) [1] ; il est vrai qu’à la différence de la France, ce pays voisin n’a plus d’empire à gérer [2]…
Cette option vient opposer un refus au Secrétaire général de l’ONU au moment où António Guterres énonce une priorité, le droit à la paix, « Une paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international ». « L’invasion de l’Ukraine par la Russie inflige des souffrances indicibles au peuple ukrainien et a de profondes répercussions mondiales » [3].
Attention, cela dit, aux « deux poids et deux mesures » : la cristallisation du monde occidental sur cette guerre n’est pas suivie par le reste du monde qui s’interroge sur le rôle de l’OTAN depuis la fin de la guerre froide, et qui conserve le souvenir de la destruction de pays, tels l’Irak et la Libye, dans l’indifférence générale.
Nous devons exiger de nos gouvernants qu’ils prennent les moyens de refuser les politiques de puissance de tous les côtés et de construire « un Nouvel Agenda pour la paix ».
Et quel bilan tirer des opérations extérieures au Sahel, si ce n’est celui de leur échec à réduire le terrorisme islamiste ? Cet échec légitime le soupçon d’une stratégie d’occupation pour d’autres motifs, notamment de type économique. Outre le développement de la misère sociale, la politique extractiviste et prédatrice, au Niger par exemple, met en danger les écosystèmes. La responsable altermondialiste, Aminata Traoré, plaide depuis 2013 pour des négociations avec les factions rebelles [4].
Ces annonces budgétaires, plutôt qu’à un lobby militaro-industriel pléthorique (Thalès, Safran, Naval Groupe, Dassault, Airbus…), seraient utiles pour les chômeurs dont les droits ont été réduits drastiquement dans la dernière période, pour une Éducation nationale, une Université et un secteur de la Santé de plus en plus en déshérence, pour le régime des retraites…
La loi sur les retraites prévoit que le statut spécial des militaires comme des policiers soit maintenu (partir plus tôt, à 57 ans voire 52 pour les policiers), alors que d’autres régimes sont remis en cause et qu’un important effort supplémentaire est demandé aux salarié-es [5]. Au nom de l’équité, la légitimité ou non de ce traitement spécifique des secteurs régaliens, spécialistes du maintien de l’ordre et de la Défense, est à mettre dans le débat public.
Une « économie de guerre », n’est-ce pas une économie parasite, au service de la stratégie unilatérale de l’OTAN et de l’Union européenne, c’est -à-dire d’une vision du monde étroitement occidentaliste ? Dans une période marquée par le regain des nationalismes souvent au mépris des systèmes démocratiques, ce serait un choix périlleux. Et comment légitimer ce choix de défense nationale, alors que les gouvernements successifs, depuis le mandat Hollande-Le Drian, démultiplient les ventes d’armes, en particulier à des dictatures du Moyen Orient responsables de la répression de « printemps démocratiques arabes » ou de guerres meurtrières (Egypte, Arabie saoudite…) ? Ce choix de production est-il compatible, par ailleurs, avec le principe d’un développement durable qui impose de limiter l’accumulation de biens inessentiels ?
Pour peser sur le débat public, actuellement dépendant d’un discours sécuritaire qui tend à devenir hégémonique, il importe que le mouvement social s’empare de ce sujet.
- Pour le rejet de ce projet de loi de programmation militaire en l’état (dans son objectif budgétaire notamment).
- Pour la démocratisation du débat public sur les questions de défense et de ventes d’armes, et une meilleure implication du Parlement.
- Pour le respect des prérogatives des Etats africains et l’arrêt des opérations extérieures au Sahel.
- Pour le soutien à la résistance des peuples contre tous les impérialismes, y compris russe, israélien, chinois…
- Pour un débat sur le maintien ou pas de la France dans l’OTAN.
- Pour un débat sur la Défense européenne et le renforcement de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.
- Pour la promotion d’une vraie diplomatie internationale, notamment dans le cadre de l’ONU, qui favorise l’accès à une mondialisation multilatérale et pacifiée [6].
- Pour un renforcement des moyens donnés à la résolution non violente des conflits et à la défense civile non violente.
- Pour l’obtention d’informations sur l’empreinte carbone des dépenses militaires.
- Pour la reconversion de certaines industries d’armement et de leurs personnels.
- Pour que la France soit observatrice lors des conférences des Etats signataires du Traité International d’Interdiction des Armes Nucléaires, comme marque d’engagement en faveur d’un désarmement nucléaire universel.
Signataires :
Nils ANDERSSON ancien éditeur-
Franc BARDOU écrivain occitaniste-
Philippe BAZIN universitaire en arts plastiques, photographe-
Nadège BOISRAMÉ, conseillère municipale à Nantes, GDS (Gauche démocratique et sociale) –
Martine BOUDET didacticienne, membre du Conseil scientifique d’Attac France-
Anne CAUWEL membre du CEDETIM, spécialiste de l’Amérique latine –
Marc CHATELLIER enseignant-chercheur (Université de Nantes), syndicaliste –
Gérard COLLET Enseignant retraité, militant associatif-
Nelly COSTECALDE, membre d’Abolition des armes nucléaires-Maison de vigilance, du Mouvement pour une alternative non-violente et de la commission paix et désarmement d’EELV-
Patrice COULON membre du MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente), d’Abolition des Armes Nucléaires, d’Attac et d’Eelv-
Pierre COURS-SALIES sociologue et membre de Ensemble!-
Fatima CUNY co-responsable de la commission Paix et Désarmement (EELV)-
Christian DELARUE altermondialiste (ATTAC et CADTM) et antiraciste (MRAP)-
Monique DEMARE membre de la commission Démocratie Attac-
Françoise DUTHU ancienne députée au Parlement Européen du groupe Verts/ALE, membre de la commission Paix et désarmement –
Thierry DUVERNOY, membre d’Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance-
Didier EPSZTAJN, animateur du blog « Entre les lignes entre les mots » –
Yann FIEVET socio-économiste-
Patrick FODELLA membre Commission Union Européenne ATTAC-
Sylviane FRANZETTI citoyenne occitaniste-
Suzanne GLANER membre de l’Union pacifiste et sympathisante de AAN et du Mouvement de la paix-
Denis GUENNEAU membre de la commission Paix et Désarmement d’EELV-
Patrick HUBERT, co-président du MAN 71-
Frédéric LEBARON sociologue, association Savoir/Agir-
Laurent LINTANF, membre du bureau de la commission Paix et désarmement d’EELV, militant antinucléaire –
Michèle LECLERC–OLIVE chercheure CNRS-EHESS, présidente de CORENS (Collectif Régional pour la Coopération Nord-Sud – Hauts de France) et de CIBELE (Collectif Régional pour la Coopération Nord-Sud – Ile de France)-
Philippe LE CLERRE, responsable du groupe local Vent de Nord-Ouest (Les Verts 77) –
Gérard LEVY co-responsable de la commission nationale paix et désarmement EÉLV ; conseiller municipal aux Clayes 78-
Olivier LONG artiste plasticien, universitaire Paris 1 Panthéon-Sorbonne-
Gustave MASSIAH, économiste altermondialiste, CEDETIM-
Françoise MAUVAIS membre d’ Attac Paris Centre-
Christophe MILESCHI professeur des universités, Nanterre-
Luigi MOSCA, physicien, membre de l’association ‘Abolition des Armes Nucléaires – Maison de Vigilance’, partner d’ICAN-
Aviva PAVLOVSKY Aide-soignante et membre du collectif Abolition des Armes militaires MDV –
Serge PERRIN animateur du réseau international du Mouvement pour une Alternative Non-violente –
Jean-Luc PICARD–BACHELLERIE membre de la commission Démocratie Attac France-
Yves QUINTAL responsable altermondialiste, Ensemble ! (Lot) –
Alain REFALO enseignant, membre du MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente)-
Serigne SARR responsable altermondialiste (Sénégal)-
Serge SENINSKY, commission Migrations Attac France-
Robert SIMON, membre de la commission Paix et désarmement d’EELV, membre du Mouvement pour une Alternative Non Violente, membre d’ATTAC-
Gérard TAUTIL responsable et auteur occitaniste-
Sabine TAUTIL enseignante- Marie Claude THIBAUD membre du CA d’Abolition des Armes Nucléaires-Maison de Vigilance –
Aminata TRAORE ancienne ministre de la Culture du Mali, présidente du FORAM/Forum pour un autre Mali
Christiane VOLLAIRE philosophe (laboratoire CRTD du CNAM et Institut Convergences Migrations au Collège de France)……
Avec le soutien du réseau CADTM Afrique et du MAN 71
(Mouvement pour une alternative non-violente de Saône-et-Loire)
[1] https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/20/emmanuel-macron-annonce-une-enveloppe-de-413-milliards-d-euros-pour-le-financement-des-armees-dans-les-sept-annees-a-venir_6158657_3210.html
La rencontre de l’OTAN de Madrid de juin 2022 est à l’origine de cette politique, qui est planifiée à l’échelle européenne
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_197574.htm[2] Claude Serfati, L’État radicalisé- La France à l’ère de la mondialisation armée (La Fabrique, 2022)
https://lafabrique.fr/letat-radicalise/
Nils Andersson, Le Capitalisme c’est la guerre, Terrasses éditions, 202&
https://www.cairn.info/revue-la-pensee-2021-3-page-154.htm
Selon les députés ultramarins, « Le président de la République et son gouvernement préparent activement une nouvelle loi de programmation militaire (…) destinée notamment à renforcer les forces dites « de souveraineté » en outre-mer afin de sécuriser les 10,2 millions de km2 composant la Zone économique exclusive de la France. Mais ils détournent sciemment le regard lorsqu’il s’agit d’assurer des conditions de vie (et de retraite) décentes aux populations des territoires qui lui assurent son rang de deuxième puissance maritime mondiale. »
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2023/02/04/les-deputes-ultramarins-condamnent-les-propos-du-ministre-de-linterieur-et-des-outre-mer/
[3] https://news.un.org/fr/story/2023/02/1132042 [4] « Ils veulent nous conduire à la guerre » Interview d’Aminata Traoré (29 Déc 2022)
https://www.investigaction.net/fr/133379/
[5] https://www.lopinion.fr/economie/reforme-des-retraites-les-principales-annonces-elisabeth-borne
[6] Mouvement de la paix, « Loi de programmation militaire (2024-2030) – A nous d’imposer la primauté du droit sur la force pour créer le droit des peuples à vivre en paix ! » (26 janvier 2023)
https://www.mvtpaix.org/wordpress/loi-de-programmation-militaire-2024-2030/
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/040423/le-projet-de-loi-de-programmation-militaire-2024-2030-un-pas-de-plus-vers-une-economie
https://nonviolence.fr/Tribune-le-projet-de-loi-de-programmation-militaire-vers-une-economie-de-guerre
https://blogs.attac.org/groupe-societe-cultures/articles-societe-politique/article/fabrication-acceleree-de-canons-caesar-et-d-obus
https://jacquesfath.international/2023/04/06/le-projet-de-loi-de-programmation-militaire-vers-une-economie-de-guerre-parasite-et-dangereuse/